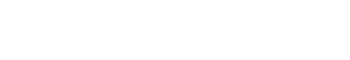RAYMOND GERVAIS
Finir
Du 11 avril au 25 mai 2012
Vernissage le 11 avril de 18h à 22h.
Comment dé-finir ?
Texte de Jacinto Lageira
La conscience de notre finitude nous pousse à achever, à terminer, à accomplir en temps et en heure un grand nombre de choses qui nous importent de crainte de ne pas avoir la possibilité de les mener à terme. L'angoisse de ne pas pouvoir finir par manque de temps le dispute toutefois à celle ne pas vouloir finir, de ne pas vouloir en finir avec le projet que l'on avait commencé, cela par procrastination, par désœuvrement, doutes, passage à vide, ou le plus souvent par acrasie, dénomination de la philosophie antique pour la « faiblesse de la volonté ». Les ouvrages d'histoire de l'art ne manquent pas d'anecdotes sur les créateurs qui n'en finissent pas de finir leurs œuvres, y travaillent continuellement – même en plein vernissage ou durant l'exposition, tel Turner –, les laissent finalement inachevées, transforment encore leur acrasie en attitude souverainement positive en déclarant leur œuvre (Le Grand Verre, après s'être brisée) « définitivement inachevée ». Le plus étonnant dans ce vaste domaine conceptuel du non-fini, de l'inachevé, de l'ébauché ou de l'esquissé (notions à nuancer) est la très grande quantité de publications, finies, sur la question. Les vues pénétrantes de certains auteurs – M. Blanchot, E. M. Cioran – ne font pourtant que complexifier cette lancinante question consistant à se demander : « comment finir » ?
Question littéralement méta-physique (au-delà du physique), car s'il est naturel que toute chose ait une fin, finir une création artistique est une opération des plus artificiels. D'autres conceptions philosophiques, esthétiques et artistiques ne prêtent pas autant d'importance à l'achèvement, au fini, puisque dans la perspective du cycle infini de l'univers rien ne meurt ni ne naît définitivement. N'oublions donc pas que l'obsession du « il faut finir » est un impératif occidental. Pour cela, il faut avoir commencé ou commencer ; mais en l'absence de commencement(s) la question de la fin ou des fins perd de sa pertinence. Mutations, continuités, transformations, transitions donnent alors une tout autre vision de notre condition. L'installation de Raymond Gervais, intitulée Finir, se rapporte plus à l'impératif abstrait qu'à son effectuation, puisqu'il apparaît assez rapidement que celui-ci n'a pas vraiment commencé une œuvre ni n'a pas non plus achevé ce que d'autres artistes – Claude Debussy et Samuel Beckett – avaient laissé en souffrance. Il fallait une certaine subtilité asiatique pour éviter ce piège logico-sémantique qui était de commencer de finir et de finir de commencer.
Écrite comme une partition, l'installation fait dialoguer Debussy et Beckett en les resituant dans les derniers moments de leur création, lorsque tous deux s'interrogeaient sur la manière de finir, sur l'éventuel échec de leur production, et donc, sur le « comment faire », puisque finir est encore faire quelque chose. Que Beckett, pianiste amateur, aimait à jouer certaines pièces de Debussy ; qu'ils vivaient à Paris où ils sont enterrés ; qu'ils se préoccupaient d'achever leur œuvre ; et, surtout, que Raymond Gervais ait déjà eu l'occasion de travailler séparément sur ces deux artistes réunis enfin ici, constitue quelques-uns des éléments de cette sobre mise en scène que son auteur nomme une « poétique du finir ». En prenant certaines phrases d'un des derniers textes de Beckett, Soubresauts (1989) (« Oh tout finir »), le titre du dernier poème de Beckett, Comment dire (1988) et les trois dernières sonates de Debussy, imaginées mais jamais composées (Sonates n° 4, 5 et 6), pour établir des résonances au propre comme au figuré entre les deux démarches, Raymond Gervais a laissé en suspens toute finition ou achèvement possible en accomplissant cependant lui-même un geste plastique, lequel est à son tour situé entre l'être et le non-être. Voilà qui est déjà beaucoup dire métaphysiquement. Cela est-il même possible ? Car ou bien il y a de l'être ou bien il n'y a rien. Certes, mais en art, il est des objets imaginaires qui, bien que n'ayant pas d'existence concrète, du fait même d'être pensés possèdent au moins une existence mentale, ce qu'en philosophie on nomme des « objets défectifs ». Les œuvres d'art sont par excellence ces objets, puisqu'ils n'existent comme tels que dans notre imaginaire, étant constitués fondamentalement de fictionnel. Dans le cas d'objets artistiques inachevés, non terminés (ce qui n'est pas la même chose que des objets finis), ou considérés comme non aboutis par leur créateur (alors qu'ils peuvent être finis), il y a une sorte de redoublement du défectif, puisque de tels objets n'existent que dans l'esprit de leur concepteur. Et, parfois, n'existeront à jamais que dans l'esprit de leur concepteur, comme cela est le cas pour les présentes sonates de Debussy, ou d'autres pièces qu'il ne considérait pas satisfaisantes. L'installation de Raymond Gervais est, ce sens, un objet défectif : son existence est en partie invisible, inaudible, sa présence est en partie imperceptible et muette, mais il peut tout à fait prendre véritablement consistance une fois pensé, imaginé, conçu par le récepteur. Un récepteur qui le complète indéfiniment mais ne l'achève pas, ne le termine pas ni ne le finit pas non plus.
Au caractère défectif de l'installation, il faudrait alors ajouter la vagueur (et cela pourrait être dit d'autres œuvres de Raymond Gervais), car si elle doit être parachevée par le récepteur rien ne nous indique que nous puissions ou que nous avons pu accéder à une sorte de résolution – comme dans l'harmonie musicale classique – de quelque dissonance. C'est là une autre esquive de notre artiste que de ne pas faire se résoudre, même imaginairement chez le récepteur, cette dissonance, bizarrerie, équivocité, car il se pourrait que cela soit impossible en dernière instance. Non que l'accomplissement, l'achèvement soit du côté du producteur ou du récepteur et lui échapperait pour certaine raison psychologique ou incompétence avérée, mais parce qu'il résiderait dans l'objet même. Il serait, pour ainsi dire, impossible à finir, à terminer, à accomplir, à boucler de fait. Car pour le finir, l'achever, il faudrait auparavant savoir où il commence. Or rien n'est moins sûr si l'on considère l'état de la réalité qui nous entoure à la fois suffisamment déterminé pour que nous puissions y évoluer et suffisamment indéterminé pour nous y perdre et ne jamais parvenir à la fin. Ce ne serait plus l'état psychique du créateur ou du récepteur qui serait à l'origine de notre (supposée) incapacité à finir, mais la réalité elle-même, concrète et tangible, qui nous entraînerait vers cette pente glissante de la vagueur du monde.
Comme le souligne le pragmatiste américain Charles S. Peirce, la vagueur (vagueness) n'est pas le rien, le néant, l'inexistant, c'est bien au contraire quelque situation entre l'indéterminé et le déterminé, parfaitement compréhensible et interprétable, mais qui nous échappe aussi partiellement pour cette même raison. On ne pourrait donc pas finir par ce que l'objet de notre attention n'est tout simplement pas finissable. Bien entendu, il l'est matériellement (le point final du texte ou de la partition), mais non pas perceptuellement. Cela heureusement, car nous ne pourrions alors plus appréhender les œuvres d'art en leur pleine expérience esthétique, autrement dit les poursuivre, les prolonger, les développer indéfiniment et infiniment en nous-mêmes. Les finir par notre réception serait signer leur mort. Lorsque nous sommes en leur présence, nous les actualisations, les rendons effectives sans pour autant assigner une limite à leur signification et plasticité. Ce que nous faisons dans Finir de Raymond Gervais est littéralement exécuter l'installation. Je l'active, nous l'activons et ainsi de suite, de sorte que l'installation n'existe que dans une exécution chaque fois unique – tel(le) réceptrice ou récepteur – et se poursuivra autant de fois qu'il y aura d'exécutant(e)s. Chaque personne peut imaginer la suite de ces mots de Beckett, de ces partitions de Debussy en des digressions infinies sur les comments des déroulements – comment continuer ? –, sur les comments des débuts – comment cela commence-t-il ? – et, bien entendu, la finalisation — comment cela finit-il ? Nous pouvons suivre certaines indications de Raymond Gervais, ou prendre plutôt la tangente, divaguer et digresser, ce qui est une autre manière – très efficace comme chez Proust (auquel Beckett a d'ailleurs consacré un essai publié en 1931) – de ne pas vouloir finir. Digresser ou reporter, recommencer, redire et refaire, rayer ou détruire, interrompre ou délaisser, quelles que soient nos méthodes dilatoires nous ne pourrons échapper à la question que se pose inéluctablement tout un chacun : comment finirons-nous ?